Journal.
Jeudi 12 décembre 1968.
Ce soir nous avons mangé le pot-au-feu que j’avais préparé hier dans l’après-midi, la viande était trop cuite et l’ensemble s’en ressentait. La machine à laver a tourné sans que je trouve le temps d’étendre le linge, qui sentira sans doute un peu demain matin. Pas de grandes discussions à table, depuis que Roland est parti plus encore on entend le bruit des fourchettes. J’ai rencontré madame Lebrun ce matin en allant aux commissions. Sa fille a la grippe. Elle ne pardonne pas cette année et le docteur Martin ne lui a prescrit que des aspirines. Le temps est blanc depuis le début de la semaine. Le froid supportable.
Vendredi 13 décembre.
A la radio ce matin ils ont parlé d’Arras, qui n’est pas si loin de Bousbecque, plus au Sud et plus à l’Ouest, sur la route qui mène de Saint-Omer à Cambrai. Ca m’a fait comme un coup de cul de bouteille sur l’arrière du crâne, en une seconde j’étais transportée par les rêves jusqu’aux roses trémières de mon Nord. J’ai regardé la route par la fenêtre, celle qui mène au centre ville, et mon jardin ; si je plisse un peu les yeux, le paysage se brouille, et par-dessus j’y installe ce que je veux. J’ai lu quelque part que pour figurer une pièce obscure, George de la Tour peignait tous les détails du lieu dans la lumière, avec tous les dégradés de couleurs correspondant, avant de les recouvrir d’une couche de peinture noire : comme s’il lui avait d’abord fallu faire naître la chambre dans son entier, avant d’éteindre la lumière (comme si l’obscurité n’était pas que l’obscurité : enceinte de tout ce qu’elle cache). Sous la couche de bitume de Sanvic sont tapies les couleurs de mon Nord : le long couloir orné de girofles, la cour, le noyer près du jardin des sœurs, les têtes rondes des hortensias, les rosiers et le potager cultivé avec tant de cœur par Monsieur Lecluse, les tomates que j’ai mangées là-bas pour la première fois de ma vie, le petit vélo sur lequel j’ai appris à rouler, une certaine séance de cirque où j’ai couché chez Marthe, Maméa, les tabliers de boulanger des bouleaux, les peupliers aux feuilles crasses. Le clocher de l’église Hallekerke, les berges de la Lys, plus loin le petit port d’Halluin et la route de Werviqc. Toute la peinture crasse, violente de mon Nord, gras comme les fumées d’usine, qu’ont recouverte un vernis sec, des écailles froides, le crachin du Havre. Je me suis sentie comme une exilée au ventre creux et, chose étrange, au lieu de cette tristesse salée, vaporeuse, comme un matin au-dessus de la Manche - qui chaque fois me saisit - c’était de la rage – une rage de dragon. Une immense colère partait de loin pour serrer mes mâchoires - une pince de homard qui aurait cuit. Cette fois-ci ça ne détrempait pas sous mes gros cheveux jaunes, ça gueulait « pourquoi ? »
Pourquoi n’a-t-on pas pu m’aimer chez moi, pourquoi m’a-t-on transportée comme une vache, comme un bras amputé, comme une tubercule, dans un train de marchandises, pourquoi ne peut-on pas m’aimer entière, pourquoi on m’a-t-on coupée ? Pourquoi j’ai dû faire de ma vie la vie des autres ? Pourquoi ce que seul je peux écrire à la première personne, ce sont des souvenirs, des regrets, des tristesses abandonnées… Je vis pour les autres, je vis dans les autres, je n’ai rien en propre que mes images du Nord, mes kilos et mes lettres ; je vis par mon mari, je vis pour mes fils, je suis une étrangère, je suis une vide - énorme et superflue, je vaque à faire vivre les autres.



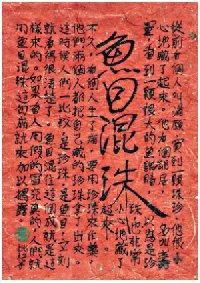












 "Ox, c'est la bestiole sous la capuche."
"Ox, c'est la bestiole sous la capuche."